ENJEUX : la nature en Seine-Saint-Denis
Indissociables de la notion de paysage, les éléments de nature sont indispensables à la qualité de vie en Seine-Saint-Denis.
Les paysages de la Seine-Saint-Denis ne sont pas faits que d’éléments urbains. Les éléments de nature représentent une sorte de « face cachée » du Département, dont les représentations sont dominées par les espaces urbanisés.
Leur valorisation doit permettre non seulement de les maintenir en place, mais aussi de les inscrire davantage dans le cadre de vie des habitants, en renforçant les articulations avec les espaces habités. L’enquête anthropologique indique combien celles et ceux qui vivent ce territoire en apprécient les ouvertures et les respirations.
En contrepoint des vastes développements urbains, les éléments de nature trouvent une part d’expression sensible, même si les enjeux révèlent que celle-ci pourrait se renforcer.
Les éléments de nature en présence peuvent jouer un rôle dans les paysages urbains, à condition d’être correctement identifiés dans les projets territoriaux. Ils se composent des éléments suivants :
- les reliefs, notamment la succession des buttes au sud du département et le rebord sud de la vallée de la Marne
- la Seine et la Marne, qui donnent au département, deux courtes séquences, mais porteuses de fortes identités grâce à l’Ile-Saint-Denis et la Haute Ile.
- les canaux, cours d’eau certes artificiels, mais dont la présence réfère à des éléments de nature au cœur de la plaine de France où ils sont moins nettement présents
- les boisements naturels restés présents sur le massif de l’Aulnoye, avec la forêt de Bondy et les massifs attenants
- les espaces encore cultivés, au nord, autour de Tremblay, et dans quelques petites poches visées par des projets urbains
- les parcs publics, qui assurent en Seine-Saint-Denis une présence des éléments de nature, confirmée par leur statut de « zones natura 2000 » qui vient compléter leur rôle d’espaces publics.
Enfin, le ciel, dévoilé dans les grandes ouvertures, les ombres et les lumières du soleil et des nuages, la pluie, le vent, sont dans le paysage, même le plus urbain, et ne manque qu’aux espaces publics couverts des transports publics souterrains et des centres commerciaux.
A lire, le rôle de ces composantes comme espaces vécus à l’échelle départementale : intensité parcs et canaux
Enjeu majeur : des composantes naturelles en régression
La carte d’Etat-Major (première moitié du 19e siècle) révèle la présence d’éléments aujourd’hui disparus du paysage, après le vaste mouvement d’urbanisation qui s’est déclenché peu après la réalisation de la carte :
- les boisements autour de Clichy « en l’Aulnoye », (devenu Clichy-sous-bois après la disparition d’une partie des boisements qui l’environnaient) et de Livry
- les cours d’eau de la plaine : la plaine de France forme le bassin versant de la « Vieille mer », qui se jette dans la Seine à Saint-Denis. Le Sausset, le Croult, le Rouillon, la Morée, la Mollette, le Moleret, le ru de Montfort, le Roussillet, apparaissent encore sur les cartes des années 1950 avant de disparaître sous l’étalement urbain.
- à l’époque de la carte, Paris a déjà étendu certains de ses faubourgs, mais sans encore atteindre le territoire de la Seine-Saint-Denis, très majoritairement agricole. La carte ne distingue pas les types de cultures, sinon les prairies qui accompagnent les cours d’eau de la plaine.
Montreuil apparaît sous la forme de très nombreuses petites parcelles, probablement maraîchères, tandis que les coteaux paraissent figurer des vergers et des vignes, leur boisement étant intervenu plus tard, après l’abandon de ces cultures.
Carte d’Etat-Major 1820, ci-dessous
Les éléments de nature ont été rehaussés : boisements et cours d’eau.
Enjeu majeur : des horizons nécessaires
L’urbanisation rapide et fonctionnelle a à la fois détruit ou recouvert une bonne part des éléments de nature (les forêts, les rus) et les cultures, elle a aussi resserré et morcelé l’espace, privant souvent les habitants d’horizons. Le besoin en est pourtant exprimé, et justifie de valoriser ce qui peut l’offrir aux habitants : les respirations, les ouvertures, les points de vue (notamment depuis les rebords des reliefs).
Orientations identifiées par l’étude anthropologique
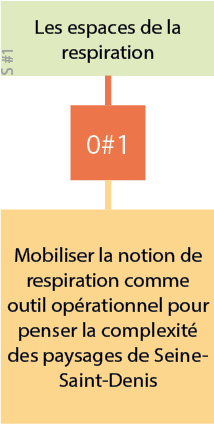
SITUATION #1
Dans le contexte très urbanisé et relativement plat de la Seine-Saint-Denis, la notion de « respiration » permet de rendre compte de la variété et de l’ambivalence des modalités qui structurent l’expérience du paysage de nos interlocuteurs, tout en montrant comment celle-ci articule échelle quotidienne et échelle métropolitaine. On respire parce que le regard peut aller loin, s’étendre prenant de la hauteur ou profitant des perspectives et ruptures qui s’ouvrent dans un tissu bâti. On respire parce qu’on peut profiter de lieux « de pause » permettant d’ouvrir sur d’autres espace-temps. On respire, encore, par le fait de pouvoir bouger parmi des univers paysager contrastés, à quelques stations de RER / métro à peine.
Si les cartes montrent comment l’ensemble de grands espaces verts du département participent largement à ce sentiment de respiration (au-delà du fait qu’ils soient réellement fréquentés), celui-ci toutefois ne s’y réduit pas. Au quotidien, et surtout dans les zones plus densément habitées, le sentiment de respiration s’appuie aussi sur un maillage des petits espaces de proximité, souvent chargés d’une importante valeur « poétique ». La reconstitution et l’intensification de la trame de continuités paysagères (Cf. Carte nature) entre l’échelle locale et globale qui identifient aussi deux modes de fréquentation différentes (les parcs s’inscrivant, comme le canal de l’Ourcq, plutôt dans la catégorie des espaces de loisir) apparaît comme une opportunité pour faire ainsi que ce sentiment puisse s’amplifier et devenir « plus large que la somme de ses parties ». Sur un autre plan la présence de l’eau, bien qu’à redécouvrir, participe d’une façon particulière à ce sentiment de respiration, tant sur le plan géographique (car l’espace en bas de chez soi peut amener loin, entre un « dedans » et un « dehors », en amplifiant ainsi l’expérience métropolitaine) que sur le plan de la « rêverie » (par le changement de « rythme » qu’elle introduit, et par sa capacité d’ouvrir vers un « ailleurs » en véhiculant un imaginaire de voyage, même si « on est à dix minutes de Paris »). Autant les grands espaces verts, que les espaces liés à l’eau entrent ici en tension avec les dynamiques foncières à l’œuvre sur plusieurs secteurs (Cf. Carte des projets) caractérisés à différentes échelles par une forte valeur paysagère (en particulier sur l’axe du canal de l’Ourcq, le long des berges de la Seine et autour de terres agricoles aux limites du département). Des questions se posent, alors, sur la place occupée par les horizons et les vues dans la réflexion plus générale sur les transformations en cours en Seine-Saint- Denis. Cette question pourrait par exemple être prise en compte dans les cahiers de charges des nouveaux projets. La fonction du paysage, entre perception individuelle et imaginaire collectif, entre vécu et projeté, pourrait d’autre part constituer le support d’une idée partagée de métropole.
Commentaires
Tous les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.